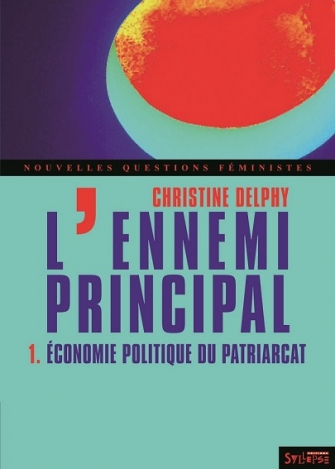Depuis un an que je lis les débats en lien avec la loi sur le mariage
pour les personnes de même sexe en France, je pense, de plus en plus,
que l'une des clés les plus importantes de ce clivage social et
politique auquel nous avons assisté, et continuons d'assister, est celle
des rapports de pouvoir, et plus spécifiquement de dominations, qui me
semblent conditionner profondément notre vie sociale, culturelle, et
même "privée".
Comme je l'écrivais il y a quelques
jours sur ma page Facebook, à propos du débat sur la lutte contre les
stéréotypes de genre à l'école:
"[...]c'est en effet sans doute là qu'est le débat: pense-t-on les discriminations comme l'expression de structures d'oppression, et le travail critique de déconstruction de ces structures comme libérateur, ou au contraire les oppressions comme des phénomènes à la marge, par rapport auquel les usages établis auraient un rôle de garde fou, mis en péril par les approches déconstructivistes. La réponse est sans doute entre les deux, mais je pense que c'est dans l'évaluation contradictoire des risques des deux approches, bien plus encore que sur les questions de genre ou de sexualité, que les différents antagonistes de notre débat s'affronte, avec des positions de part et d'autre plus ou moins nuancées, plus ou moins radicales."
Par exemple:
l'homophobie est-elle un phénomène condamnable mais minoritaire, qui se
caractérise par des violences verbales et physiques à l'encontre des
homosexuels, ou bien est-elle une structure culturelle qui contribue, de
manière assumée ou parasitaire, à l'ensemble de nos jugements, que nous
y soyons favorablement ou défavorablement disposés, sur l'insertion de
cette minorité?
Ou encore, le racisme ne se résume-t-il
qu'à une survivance résiduelle, repérable dans certains faits divers
dus au actions inconsidérées,ponctuelles et à la marge de déséquilibrés incultes ou aux délires non représentatifs de factions politiques extrémistes, que la majorité d'entre nous condamnons, y compris dans l'Eglise, ou demeure-t-il présent dans les
représentations socio-culturels de la totalité d'entre nous, que nous
soyons militants de SOS racisme, du Bloc Identitaire, ou toute autre
alternative plus ou beaucoup moins "marquée"?
Pour
répondre à ces questions, je définirai dans les lignes qui suivent trois
repères à mon avis essentiels pour comprendre cette notion de
domination, dans un contexte politique, social et culturel: l'hégémonie,
l'asymétrie, et l'intersectionnalité. Puis je conclurai sur la
nécessité de reconnaître aux minorités la légitimité de leur propre
voix, plutôt que de leur imposer, comme par décret, une autre venue d'en
haut, censée réconcilier leurs intérêts avec ceux "universels" ou
"communs", pour leur permettre d'influer sur nos représentations
communes, et faire évoluer nos représentations hiérarchiques
inconscientes ou semi conscientes vers une recherche toujours, certes, à
renouveler, mais toujours en quête, d'une plus grande égalité.
1) Les rapports de domination: des relations hégémoniques:
Les
différentes luttes contre l'oppression de telle ou telle minorités
(qu'il s'agisse de genre, d'orientation sexuelle, d'origine raciale
et/ou ethnique) ont généralement en commun l'idée que la domination de
telle ou telle catégorie sociale/religieuse/sexuelle etc. ne se réduit
pas à un ensemble de mesures coercitives explicites pour garantir celle-ci, ni à une quelconque volonté consciente de conserver le pouvoir ou de maintenir une hiérarchie, mais à une hégémonie culturelle et sociale, dont elle tire à la fois son origine et sa force pré discursive et pré réflexive d'"évidence", généralement à l'insu même des individus qui la composent et qui en bénéficient.
Ce concept d'hégémonie culturelle, repris par le champ universitaire des cultural studies et par différents mouvements d'émancipation des minorités, a été forgé par le philosophe marxiste italien Antonio Gramsci:
"Comment peut-on comprendre le consentement populaire ? Plus exactement, comment comprendre que puissent se former dans des sociétés de masse des consensus en faveur des classes dirigeantes ? Comment expliquer, par exemple, qu’au Royaume-Uni, les classes populaires aient adhéré au thatchérisme ? Le projet général des cultural studies entend répondre à ce type de questions. Il faut pour cela cesser, comme le fait la tradition marxiste, d’envisager la culture comme superstructure. Si les cultural studies ont une unité, celle-ci tient à la volonté de travailler avec et contre le marxisme (p. 20). La culture ne reflète pas, de manière résiduelle, les rapports de force économiques. Elle doit être pensée davantage comme une dialectique entre conscience sociale et être social : elle englobe à la fois « les significations et les valeurs qui se forment parmi des classes et des groupes sociaux caractéristiques, sur la base de leurs relations et de leurs conditions historiques données », et « les pratiques et les traditions vécues, à travers lesquelles ces « compréhensions » s’expriment et dans lesquelles elles s’incarnent » (p. 43). Une telle définition suppose que l’on place la question de l’idéologie au cœur de la réflexion sur les productions culturelles, à condition toutefois de la concevoir, comme le fait Gramsci, davantage en termes d’hégémonie qu’en termes de contrainte exercée sur les masses par les idées dominantes. Ce déplacement est nécessaire ; à s’en tenir à l’analyse marxiste classique de l’idéologie, qui associe classes dirigeantes et idées dominantes, on ne peut comprendre le libre consentement des dominés. La notion de « fausse conscience », par laquelle le marxisme classique explique que les masses sont idéologiquement trompées par les classes dominantes, n’est pas satisfaisante. Elle repose sur une conception simpliste de la conscience, comme s’il suffisait aux masses de dissiper le voile d’ignorance qui les aveugle pour voir la réalité telle qu’elle est. En outre, elle suppose que les intellectuels marxistes, contrairement aux masses, échappent aux illusions." (La Vie des Idées,"Critique de l'hégémonie culturelle: à propos de Identités et cultures de Stuart Hall", par Florent Guénard).
Au delà du cadre marxiste initial, ces analyses sur l'hégémonie culturelles s'avèrent très utiles pour comprendre les mécanismes immanents de mise à la marge, et de silenciation des minorités, sans avoir à recourir de manière nécessaire à l'hypothèse d'une volonté consciente et délibérée, par par les individus qui composent le ou les groupes dominants, de confisquer l'exercice du pouvoir à leur profit ou de défendre leurs privilèges:
" Penser la culture comme hégémonie, c’est ainsi dépasser le fonctionnalisme qui consiste à ne voir dans les médias que des instruments au service des classes dirigeantes. Libres de toute contrainte externe, les médias, qui sont responsables de la description et de la définition des événements survenant dans le monde, fixent le langage à partir duquel est produite la signification (p. 95). C’est ce qu’enseigne le structuralisme selon Stuart Hall : les choses ne contiennent pas leur propre signification, celle-ci est produite par le langage, qui est une pratique sociale. Les médias donnent du sens, et c’est en cela qu’ils assurent l’hégémonie : l’idéologie est moins un ensemble déterminé de messages codés qu’un système de codification de la réalité (p. 100). C’est de cette manière, par exemple, qu’ils construisent une idéologie raciste : non en se faisant l’écho d’une conception ouvertement raciste du monde, mais en supposant que le monde n’est intelligible que rapporté à « des catégories de race » (p. 197).
C’est contre de telles constructions que les politiques culturelles noires se sont mises en place. Pendant longtemps, souligne Stuart Hall, ces politiques ont consisté à dénoncer le caractère stéréotypique et fétichisé de la représentation des Noirs, et à lui opposer une image positive. Mais changer les relations de représentation ne modifie pas substantiellement le racisme culturel encore dominant. C’est pour cette raison qu’il faut mettre en œuvre une politique des représentations, organisée autour de la reconnaissance de « l’immense diversité et différenciation de l’expérience historique et politique des sujets noirs » (p. 206), afin de montrer que la notion de « race » ne peut en aucune manière justifier une politique culturelle. L’identité culturelle noire est plurielle, faite de différences, de discontinuités, de ruptures. La notion de différance, forgée par Jacques Derrida, permet d’en rendre compte : le sens est toujours au-delà de la clôture qui le rend possible. L’identité culturelle noire n’est pas essentialisée ; elle est historique, elle est production incessante de soi, « la culture n’est pas affaire d’ontologie, d’être, mais de devenir » (p. 262)." (Florent Guénard, op.cit.).
La méconnaissance de ce concept d'hégémonie, dans les milieux catholiques, est à mon avis la clé de la vive incompréhension suscitée par des termes tels qu'"homophobie", "patriarcat", ou encore par l'analyse de l'islamophobie comme étant un discours raciste post colonialiste.
Lorsque par exemple tel ou tel dénonce l'homophobie, il ne s'agit pas nécessairement de stigmatiser une volonté délibérée de nuire aux homosexuels ou de les rabaisser, mais de montrer que les termes dans lesquels ont été menés, par exemple, les débats sur l'homoparentalité, du côté de la Manif pour Tous, ne peuvent aboutir qu'à une vision hiérarchique des orientations sexuelles, qui présuppose l'idée suivant laquelle l'hétérosexualité serait du côté de la norme, et l'homosexualité de celui de la déviance ou de l'anomalie, quelle que soient par ailleurs les bonnes dispositions, par ailleurs souvent très sincères, de nombreux militants de celle-ci à l'encontre des personnes homosexuelles qu'ils connaissent ou dont ils ont entendu parler, ou de leur volonté de contribuer à améliorer la situation sociale de celles-ci et atténuer leurs "souffrance". De dénoncer par exemple le passage obligé, imposée par les adversaires de la loi Taubira, d'une grille de lecture par le crible d'un ordre "naturel" ou "symbolique" qui fonde la filiation sur la complémentarité des sexes, qui est à rebours des acquis actuels de l'anthropologie, la sociologie, l'ethnologie et l'histoire en tant que disciplines scientifiques, mais qui conserve un caractère d'"évidence" ou de "bon sens" aux yeux d'une bonne partie de la population, parce que l'immense majorité de nos représentations culturelles, sociales, juridiques, nous habituent à l'idée que le seul mode "naturel" de relation de couple, et a fortiori de parenté, est celui qui unit un homme et une femme, invisibilisant, par son omniprésence culturelle, son hégémonie, les nombreux autres modes qui existent dans notre société et qui sont vécus au quotidien par de nombreuses personnes.
De même, le patriarcat, ce n'est pas seulement le machisme, le partage inégal des taches dans la vie de couple,le harcèlement sexuel ou les blagues grassement misogynes. Ce sont l'ensemble des discours et des représentations qui justifient une dichotomie entre l'homme et la femme, fondée sur une supposée différence de nature, à partir de laquelle on va valoriser, chez une femme, certaines activités, certains actes, certaines attitudes, et en dévaloriser d'autres, quelles que soient par le respect ou l'affection de ceux qui véhiculent ces représentations, ou leur bienveillance envers le mouvement féministe. La galanterie, par exemple et si j'ai bien compris, est sexiste et patriarcale, en ce qu'elle accrédite l'idée d'une plus grande fragilité, d'une plus grande faiblesse des femmes, qui justifierait des attentions particulières. Derrière les bonnes intentions qui accompagnent ce comportement, et le fait qu'il soit agréable à certaines femmes, reste le stéréotype inégalitaire qu'il présuppose, et qu'il renforce: les femmes seraient moins capables dans certains domaines, et plus fragiles, que les hommes. De manière comparable, la distinction entre "madame" et "mademoiselle", qui a longtemps pu sembler relever du respect ou de la simple politesse, accrédite l'idée que la vie d'une femme se détermine par sa capacité à avoir fondé ou non une famille, et partage les femmes, de manière clairement repérable, entre celles qui ont atteint cet objectif et celles qui ne l'ont pas atteint. Alors que les hommes ne sont pas contraints par une telle classification sociale. Le combat contre l'utilisation de "mademoiselle" dans les documents administratifs, qui a pu sembler être du chipotage à certains, est donc incontournable, au sens où il s'agit d'interroger le caractère foncièrement inégalitaire des représentations de la différence des sexes dans notre langue la plus commune, et nos "évidences" culturelles les plus largement partagée. Et qu'il y ait eu tant de résistance, de la part de ceux-là mêmes qui y dénonçaient des broutilles, montre a contrario combien ce combat touche à des discours sur la femme profondément ancrés dans nos présupposés culturels. L'hégémonie culturelle c'est cela: non pas un "complot" des hétéros contre les homos, ou des hommes contre les femmes, mais tout un système d'"évidences" introduites subrepticement, par l'exercice souvent inconscient de privilèges, dans notre langue et notre culture, qui créent et renforcent des situations inégalitaires, qui instituent de la norme et de la déviance, et qui font que ceux-là mêmes qui sont dépossédés se convainquent que leur situation socialement et/ou culturellement inférieure est le fait de leur propre "nature", et non d'une injustice qu'ils pourraient dénoncer, et croient souvent vertueux et/ou réaliste de s'y soumettre (la prégnance de ces représentations hégémoniques sur nos habitudes et nos représentations explique d'ailleurs la persistance de certains stéréotypes de genre dans des pays très avancés dans la lutte contre ces derniers, comme la Norvège: il ne suffit pas de modifier les représentations par "en haut" pour leur faire perdre leur caractère hégémonique. une lutte de type culturel, et non seulement politique, de longue haleine, est nécessaire) .
De façon analogue, l'islamophobie présente souvent un caractère raciste, dans la mesure où elle s'appuie sur des représentations (les barbus dans les cités, les terroristes arabes, l'"islamisation" par le biais de l'immigration) qui assimilent clairement le musulman à l'étranger, et l'étranger à celui qui vient remettre en cause à son profit l'ordre établi. Ces représentations, qu'ont trouve de nos jours aussi bien à gauche qu'à droite, participent d'une certaine hégémonie chrétienne et blanche (j'entends ici par "chrétienne" un certain cadre culturel encore dominant d'inspiration chrétienne, pas la foi chrétienne en tant que telle. Le christianisme n'est pas raciste en lui-même, au contraire, mais l'habitude de repères culturels d'inspiration chrétienne peut expliquer en partie le rejet de certains occidentaux vis à vis de marqueurs culturels explicitement liés à d'autres traditions religieuses) qui influe sur les jugements, y compris de personnes qui ne sont parfois ni blanches ni chrétiennes, ni nécessairement bien disposées à l'égard du christianisme en lui-même.
(soit dit en passant, j'ai beaucoup de mal à comprendre la signification, chez un mouvement tel que les Veilleurs, qui rejette la plupart des critiques de notre ordre culturel du type de celles que je viens d'évoquer, comme l'argument de l'homophobie, et qui défend l'hégémonie d'un certain nombre de valeurs (ainsi la "complémentarité" des sexes) de lectures publiques ou de citation sur des blogs militants de textes de Gramsci, qui semble se situer dans une démarche philosophique et politique radicalement contraire à la leur).
2) Les rapports de domination: des relations asymétriques:
Tenir que notre relation du monde est constamment travaillée par un tissu de représentations culturelles inégalitaires, qui naturalisent des différences construites, et qui font que ceux-là mêmes au détriment desquels l'hégémonie culturelle répand son discours se persuadent, bien souvent, qu'il n'est question que d'évidences et de "réalité", c'est prendre conscience que nous ne sommes jamais à égalité les uns avec les autres dans nos prises de positions sociales, politiques et culturelles. Dans un débat sur l'homosexualité, un hétérosexuel et un homosexuel ne discutent jamais à armes égales, de même qu'un homme et une femme sur le sexisme, qu'un blanc et un noir à propos du racisme. L'hégémonie de certains types de modes de vies, d' origines, de d' identités sur d'autres, a pour conséquence que nous sommes toujours déjà plongés dans un rapport inégalitaire à notre prochain, en fonction de notre classe sociale, de notre sexe, de notre race, de notre religion, de notre orientation sexuelle ou autres, suivant notre adéquation ou notre inadéquation à tel ou tel aspect du ou des modèle(s) dominant(s)... Ce qui justifie l'idée, souvent très mal comprise, voire combattue, que les dominants sont généralement bien moins qualifiés que les dominés pour déterminer les stratégies pertinentes pour remettre en cause leur propre hégémonie, et que le transfert discret mais bien souvent réel de celle-ci dans la lutte elle-même contre les inégalités est aussi à combattre et à proscrire.
Ce que la sociologue féministe Christine Delphy explique dans un texte célèbre, "Nos amis et nous", repris dans le premier tome de L'Ennemi Principal (ed. Syllepses), où elle dénonce, en 1975, les tentatives insidieuses de prise de contrôle du mouvement féministe par certains sympathisants hommes, prétendument pour que les exigences de celui-ci soient mieux entendues. Elle s'appuie, pour les besoins de sa démonstration, sur l'histoire du mouvement d'émancipation des noirs aux Etats-Unis:
"Cette démystification a été l’œuvre de la « nouvelle révolution noire » aux États-Unis, qui a commencé en 1965 par l’exclusion des Blancs des organisations de « droits civiques ». Cette révolution a mis un terme à cinquante ans de réformisme sur le problème racial, cinquante ans de paternalisme blanc. En effet le fonctionnement de ces groupes était fondé sur un déni de réalité, un faire-semblant constant. On faisait semblant, comme le propose Alzon, que la situation où les Blancs étaient oppresseurs et les Noirs opprimés était sans influence sur le fonctionnement des groupes de droits civiques :
sur leur politique
sur la structure de pouvoir de ces groupes.
On faisait comme si l’inégalité intrinsèque caractérisant les rapports entre Noirs et Blancs était annulée dès qu’on entrait dans le local de l’organisation. On niait que les Blancs apportaient des ressources politiques supérieures - leurs meilleures connaissances de l’ accès à la structure du pouvoir - et des ressources, qu’on doit pour l’instant, faute d’un autre mot, appeler « psychologiques », supérieures. Comme on ne peut lutter contre ce que l’on ignore, ce que l’on nie, ces facteurs jouaient donc pleinement et sans frein, avec le résultat inévitable que les Blancs occupaient une position privilégiée jusque dans les organisations consacrées à « l’amélioration du sort des Noirs ».
Mais leur présence, en dehors même de toute position dominante dans la hiérarchie du groupe lui-même, avait des conséquences encore plus fondamentales, c’est-à-dire dans des domaines encore plus importants :
dans la définition des objectifs, qui elle-même est liée à la définition du combat, c’est-à-dire de l’oppression contre laquelle on est censé lutté : les Noirs ne pouvaient en présence des Blancs reconnaître leur propre oppression : d’abord ils ne pouvaient, même s’ils la voyaient, dénoncer la position dominante des Blancs dans le groupe lui-même, puisque le dogme, la représentation officielle du fonctionnement du groupe, dont dépendait l’existence du groupe en tant que tel, c’est-à-dire en tant que groupe mixte, déniait a priori la possibilité d’une telle chose :
surtout, que les Blancs du groupe aient ou non des positions individuellement dominantes, leur présence renforçait la tendance à adopter la définition dominante, c’est-à-dire la définition blanche de ce dont les Noirs « souffraient ».
Cette idéologie, cette définition par l’oppresseur de ce qu’est l’oppression, diffuse au dehors, intériorisée par les Noirs, était incarnée par les membres blancs du groupe. N’étant pas noirs, ils l’exprimaient « sincèrement », et il était d’autant plus difficile pour les Noirs d’y opposer leur définition que celle-ci n’existait pas vraiment, tandis que la définition des Blancs était la définition officielle. L’opinion des Blancs était donc soutenue à la fois par l’ensemble de la culture - dont les Noirs participent - et par leur prestige d’oppresseurs.
Là résidait un des points cruciaux. Car non seulement ce prestige empêchait les Noirs de trouver leur définition de leur oppression, mais en retour la présence des Blancs les empêchait de lutter contre le prestige que ceux-ci avaient à leurs yeux. En effet, les Noirs ne pouvaient à la fois voir des Blancs et ne pas les voir d’une façon positive : ne pas les admirer, ne pas désirer être eux, puisque ceci est à la fois un des résultats, une des manifestations et un des moyens de l’oppression. Être en présence de Blancs, les voir, c’était dans le même temps et avoir une image positive de la blancheur et en prendre conscience. En prendre conscience, c’était prendre conscience dans le même temps de la base, de la condition nécessaire de cette image positive : l’image négative de la noirceur, et prendre conscience que cette image non seulement existait, mais subsistait et jouait à l’intérieur d’un combat de « libération ».
Ce n’est pas un hasard si l’exclusion des Blancs a coïncidé et avec la mode « afro », qui est bien plus qu’une mode ou même qu’une thérapie, et avec l’apparition du slogan « Black is beautiful ». La non-mixité était la condition logique et historique de la lutte contre la haine de soi. Les faits concrets, l’histoire concrète de la lutte, et des Noirs et des femmes, comme les implications logiques de la proposition que la libération des opprimés est d’abord, sinon seulement, l’œuvre des opprimés, amènent à la même conclusion : les oppresseurs ne sauraient jouer le même rôle dans les luttes de libération que les opprimés."
Cette intrusion du point de vue hégémonique dans le discours de libération des minorités est aujourd'hui dénoncé, dans les milieux féministes, sous le nom de "mansplaining" ("mecsplication" en français), comme la blogueuse féministe A-C Husson l'a rappelé il y a un peu plus d'un an sur son blog:
"[...] il s’agissait de mettre un pont final à une discussion en expliquant à une féministe qu’elle se fourvoyait, parce que lui savait ce que le "vrai combat du féminisme" devrait être. Il me l’a redit plus tard, ce n’est pas quelque chose qui lui a échappé: il est persuadé de savoir, mieux que nous, ce que doit être le féminisme, même s’il emploie indifféremment les mots "sexe" et "genre", et parle de "genre sexué", ce qui ne veut rien dire. Bref.
Qu’une chose soit bien claire. Comme je critiquais cette attitude, il m’a accusée de vouloir exclure les hommes du combat féministe. Loin de moi cette idée, les hommes sont indispensables à ce combat, puisque les féministes se battent pour l’égalité des genres. En revanche, je refuse qu’un homme m’explique comment, quand et pourquoi être féministe. De même, je me considère comme anti-raciste mais en tant que blanche, il est hors de question que je me substitue aux premier.es intéressé.es dans ce combat.[...]
Le coup du mansplainer qui explique à une féministe comment être féministe, c’est un classique. Un cliché. Une étape obligée. Tou.tes les féministes connaissent cela. C’est même une case dans le bingo féministe, qui répertorie toutes les réponses les plus communes destinées à clouer le bec aux féministes. Ces réponses peuvent être le fait d’hommes ou de femmes. Citons les incontournables "Moi, je vais te dire ce qui ne va pas dans le féminisme" et "Les féministes se plantent, c’est l’égalité qu’il nous faut"." (Genre!, "Bingo féministe et mansplaining...").
Comme A-C Husson le rappelle, ce n'est pas parce que les dominants sont moins bien placés que les dominés pour dénoncer la condition de ces derniers qu'ils n'ont aucune contribution intéressante à apporter. Je serais en tout cas, personnellement, mal placé pour dire le contraire, moi qui, blanc, hétéro et homme, traite dans mes billets du racisme, de l'homophobie et du sexisme. Mais aussi "ouvert" que je m'efforce d'être, je demeure marqué par une éducation qui valorise davantage certains aspects de mon identité que d'autres qui sont le propre des personnes auxquelles je m'intéresse et dont j'essaie de comprendre et promouvoir le point de vue. J'ai beau lire depuis plusieurs mois des textes féministes et essayer d'en défendre le point de vue, j'ai souvent tendance à rester curieusement inerte, quand je déjeune chez mes parents, lorsque ma mère vaque à telle ou telle tache ménagère "habituelle". J'ai pris parti pour le "mariage pour tous", mais face à tel ou tel coming out, je me sens souvent un peu désolé, comme si mon interlocuteur m'annonçait une maladie ou un handicap. Je me suis toujours considéré comme étant fermement anti raciste, mais quand un jeune maghrébin en survêtement et casquette ("admirez" au passage mon aisance dans l'énoncé de clichés racistes) m'aborde dans la rue, poliment, pour me demander un renseignement banal, et que j'arrive à réprimer mon sentiment initial de peur pour lui répondre de façon courtoise et constructive, j'ai tendance à forcer mon empressement et à me flatter intérieurement de ma merveilleuse "ouverture" d'esprit, comme si le traiter comme j'attends moi-même d'être traité était un service que je lui rendais. Je suis conscient que beaucoup de personne de catégories dominantes font beaucoup mieux que moi, confrontées à certains des exemples que je viens de citer, mais mon témoignage me semble illustrer clairement que la bonne volonté ne suffit jamais tout à fait, quand il s'agit de contribuer à l'émancipation de personnes dont la condition semble moins valorisée socialement sur tel ou tel point, et que dans les relations qu'un homme a à une femme, un blanc à un non blanc, un hétéro à un homo, le passif des stéréotypes culturels influe toujours de manière suffisamment significative sur leurs interactions et leur regard sur l'autre et sur eux-mêmes, pour que leurs paroles et leurs actes l'un vis à vis de l'autre n'aient jamais tout à fait le même poids, que leur désir souvent sincère d'équité soit faussé par les présupposés culturels qu'ils partagent (ou non d'ailleurs).
C'est pourquoi il est important que cette inégalité "originelle" soit prise en compte dans les discours et les stratégies d'émancipation. Quelle que soit ma sincérité à vouloir contribuer à l'amélioration des conditions de vie de personnes moins privilégiées que moi sur tel ou tel aspect, comment savoir si le "juste milieu" que je peux être tenté de proposer, lors de tel ou tel débat militant, entre leur indignation légitime et ce qui me semble audible par la "majorité" que je "représente" est véritablement l'expression constructive d'un point de vue "modéré", ou si l'enjeu repose sur un compromis entre ma culpabilité et mon désir de ne pas remettre en cause un certain nombre de facilités, de représentations et de privilèges qui me facilitent tout de même bien la vie? La réponse à cette question est bien évidemment différente pour chaque personne, et quasiment impossible à trancher en toute sincérité. Mais précisément parce qu'elle témoigned'une d'une ambiguité constitutive des relations entre dominants et dominés, il importe que la parole de ces derniers, l'expression de l'aliénation qu'ils vivent au jour le jour, à des degrés divers, et des arguments et des ressentis qu'ils opposent à cette dernière, soit rendu auvisible de la manière la plus directe possible, et que donc les "alliés" s'effacent face à ces témoignages, autant que leur aura symbolique efface ceux qu'ils cherchent à aider dans la "vraie vie".
On peut trouver ce point de vue "culpabilisateur". C'est ainsi le point de vue d'un billet tout récent, émanant d'un catholique et dirigé contre la dénonciation féministe d'une "culture du viol". Cependant, cette idée de culpabilité, c'est-à-dire d'une prise d'ascendant morale sur son interlocuteur, en vertu d'une certaine formulation d'une certaine mise en contexte, n'est que le miroir de cet ascendant culturel qui fait, trop souvent , comme je le rapportais dans des billets précédents, qu'on va estimer qu'une fille en jupe ou noctambule ne doit pas "s'étonner de ce qui lui pend au nez", et qu'on va inversement minimiser le viol du fait des "instincts" ou du "contexte" ( il n'y a qu'à voir comment même à gauche, en principe un terrain favorable au féminisme, on se montre à l'occasion indulgent en matière de "troussage de domestique"). Si je ne soupçonne absolument pas l'auteur du billet (que je croise à l'occasion lors de twittapéros cathos) d'aller aussi loin, ni de sympathiser avec ces exemples, il me semble qu'il ne voit pas qu'il ne s'agit pas de nécessairement de "culpabilité",au sens où on devrait s'avouer coupable d'actes d'autres personnes, mais de la prise de conscience de tout ce qui dans nos présupposés fausse notre regard face à la femme violée, et rend bien souvent difficile, au quotidien, la reconnaissance sincère et pleine de la violence qui lui est faite. Et de nous demander (moi aussi bien que lui ou d'autres) sincèrement, humblement, ne serait-ce, dans un premier temps, que dans le secret de notre coeur, pourquoi?
Dans le même ordre d'idée, il est parfaitement irrecevable d'accuser les gay games de "discrimination liée à l'orientation sexuelle". L'acte de discriminer, en effet, s'inscrit dans une relation de pouvoir, qui différencie celui qui détient ce dernier et celui qui le subit. Qu'une orientation minoritaire soit interdite de participation à une manifestation sportive la reconduit à son néant culturel et social, en terme de reconnaissance. Qu'une majorité subisse le même traitement, et ce néant, par contraste, est rendu visible. Il ne s'agit donc plus d'exclusion à proprement parler, mais d'une mise en position d'agir, d'un "empowerment" dd'une minorité (je reviendrai en conclusion sur cette notion).
On voit donc pourquoi des tentatives de renverser les discours d'émancipation des minorités, telles que la dénonciation, dans un contexte occidental post-colonial, d'un "racisme anti-blanc", sont tout à fait impropres. Comme Christine Delphy l'écrivait, dans le texte cité plus haut:
"Le retournement de l’accusation de racisme est une réaction classiquement défensive et une défense classiquement réactionnaire. Et cela fait quelque temps déjà que l’on voit les femmes accusées de sexisme par des gens qui souvent n’en connaissent même pas le sens originel, mais qui ont l’excuse de ne pas poser aux « révolutionnaires », encore moins aux « féministes ». L’accusation de « contre-racisme » ou de « sexisme à l’envers » est typiquement réactionnaire : elle l’est déjà a priori, avant tout examen, en cela seul qu’elle pose implicitement une symétrie entre oppresseurs et opprimés. Il est incroyable qu’on ose proférer de telles choses à propos des Noirs, dont le mouvement (aux Etats-Unis) est plus ancien, plus connu et plus reconnu, que celui des femmes. Il est incroyable que quiconque se prétendant non seulement au courant des luttes, mais de surcroît « spécialiste », fasse preuve d’une telle ignorance, au sens premier d’absence d’information : et que quelqu’un qui ignore des faits élémentaires de l’histoire contemporaine ose aborder le sujet. En effet, le « concept » de « contre-racisme » a été démystifié depuis longtemps pour ce qu’il est : une tentative d’intimidation." (Christine Delphy, op. cit.).
Ce qui ne signifie nullement qu'il est en soi inenvisageable d'être en désaccord avec un militant d'une minorité quant à certains points de son discours ou son attitude ou certains de ses actes, ou avec certaines idées et certains arguments avancés, mais que notre évaluation de ces derniers ne doit nullement nous aveugler quant aux facilités de notre propre situation, et quant à notre illégitimité à prétendre dire mieux qu'un "plus petit que nous" le contenu et la signification de ses souffrances et/ou de sa fierté d'être ce qu'il ou elle est, et pour tout dire de son identité sociale et culturelle de dominé.e qui lutte pour reprendre le contrôle de ce qu'il ou elle est et peut devenir, et de la manière dont il ou elle est décrit.e.
3) Les relations de domination: des imbrications complexes:
Une objection tout à fait intéressante aux lignes qui précèdent serait de souligner qu'aucune société ne se divise aisément en deux blocs, l'un dominant, et l'autre dominé. une femme blanche est dominante par rapport à un homme noire du point de vue de l'antiracisme, et dominée du point de vue du féminisme. Une militante féministe blanche, dans son combat pour l'émancipation, peut être amenée à s'exprimer au nom de toutes les femmes, alors que la situation d'une femme noire au regard de l'hégémonie culturelle ne sera pas nécessairement la même que la sienne. La lutte en faveur des minorités, contre l'"hégémonie culturelle", n'est-elle pas destinée, dans son essence, à se contredire elle-même?
Il s'agit là d'un problème bien connu des militants pour l'émancipation des minorités, celui de l'intersectionnalité des problématiques de domination et de la convergence des luttes. Comme A-C Husson le souligne:
Comme la philosophe féministe Elsa Dorlin le rappelle:
Malgré son intérêt, et son très grand succès, il demeure cependant difficile à manier, dans la mesure où son efficacité comme descripteur de l'imbrication des rapports sociaux-culturel ne doit pas faire passer à l'arrière-plan sa dimension critique:
La thèse suivant laquelle la voix des dominés doit être prédominante dans la dénonciation et l'émancipation de l'hégémonie culturelle qui les invisibilise et les alène, a pour corrélat une certaine défiance envers les politiques topdown de lutte contre les discriminations, et a conduit à l'élaboration de notions telles que l'agency (la capacité à agir) ou l'empowerment, destinées à thématiser d'une prise de conscience et d'une libération par la base, sans passer par la médiation de dispositifs ou de discours liés à des catégories dominantes (au passge, prétendre par exemple que les femmes peuvent renverser les rapports de domination par leur "génie" propre, par exemple la séduction etc., et que donc le patriarcat en tant que concept serait simpliste, c'est oublier, ou feindre d'oublier, qu'on leur assigne alors comme instrument de leur "libération" les chaînes mêmes qui les lient à un "idéal" féminin abstrait, et redoubler leur aliénation: telle femme est-elle "suffisamment" séduisante, etc.? Ce sont à elles de décider de ce qui les libère, et non à quelque conception préétablie d'en haut et réductrice de déterminer ce qu'est leur "génie") :
Et de fait, et sans idéaliser outre-mesure les politiques des identités à l'anglo-saxonne, c'est belle et bien la prise de conscience politique des minorités (qu'il s'agisse des femmes, des noirs, des homosexuels, etc.) et leur activisme qui a mené à une amélioration significative, aux 20ème et 21ème siècle, de leur condition. Les beaux principes humanistes abstraits de la République n'y ont pas suffit, même s'ils ont pu les faciliter dans une certaine mesure. Ni d'ailleurs la conception du "bien commun" défendue par l'Eglise, dont on peut se demander si, à force de privilégier la complémentarité et la collaboration entre les classes et les sexes et le statu quo, elle ne finit pas par de fait, au non de la non violence, par renforcer l'hégémonie et les privilèges de quelques uns, et instituer un monopole de la violence structurelle et du pouvoir social. De fait, il est difficile de retracer ce qui revient à l'Eglise dans l'émancipation (il y a eu des choses très importantes, et la théologie du corps de Jean-Paul 2 est à certains égards par exemple une tentative de prise en compte certaines revendications féministes, mais l'Eglise n'a pas été pilote dans ces combats comme elle aurait pu, à mon sens, l'être), qu'aujourd'hui peu de catholiques remettent en cause, de ces minorités, alors qu'on peut trouver assez facilement des moments où elle semble avoir tenté de les freiner, voire de les stopper.
Tant que l'Eglise n'aura pas pris toute la mesure et l'urgence de ces questions d'hégémonie culturelle et d'émancipation des exclus et des dominés par eux-mêmes, leur témoignage et leur réappropriation de ce qu'ils sont et veulent devenir, et non par quelque discours bienveillant (voire paternaliste) généraliste et venu d'en haut, elle n'aura pas à mon sens dépassé les objections, contre sa doctrine sociale, de la gauche athée, ni celles en provenance de sa propre composante d'ouverture.
Il s'agit là d'un problème bien connu des militants pour l'émancipation des minorités, celui de l'intersectionnalité des problématiques de domination et de la convergence des luttes. Comme A-C Husson le souligne:
" Cette critique rappelle (sans aucun doute de façon délibérée) la critique au fondement du concept d’«intersectionnalité". Dans un article fondateur ("Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur"), la féministe noire K.M. Crenshaw développe cette critique au sujet, non pas du mouvement LGBT, mais du mouvement féministe. Elle explique que des politiques fondées sur l’identité, comme les politiques féministes, tendent à minimiser ou ignorer les différences au sein de la communauté qu’elles sont censées représenter. Elle s’appuie pour cela sur les critiques internes au mouvement apportées par le "Black feminism" (explication en français ici). L’article porte plus spécifiquement sur la question des violences machistes: "S’agissant de la violence contre les femmes, une telle élision s’avère pour le moins problématique, car les formes de cette violence sont fréquemment déterminées par d’autres dimensions de l’identité des femmes — la race et la classe par exemple". Cette "élision" se retrouve dans les stratégies militantes:Un exemple emblématique en France des difficultés pointées par ce concept est la polémique récurrente autour des femmes musulmanes voilées. Doit-on choisir entre la défense des minorités musulmanes, et de leur droit à pratiquer leur religion, et celles des femmes contre les oppressions qu'elles subissent? Des féministes occidentales non musulmanes ont-elles plus de légitimité pour dire ce que doit être la liberté de la femme musulmane que celles qui revendiquent le port du voile, non comme un acte de soumission aux diktats d'une société patriarcale, mais au contraire comme un acte positif d'affirmation de leur identité à la fois religieuse et féministe, à la fois contre le sexisme présent dans leur culture d'origine, en relisant leur foi à l'aune des outils critiques du féminisme et des études de genre, et contre la mentalité colonialiste occidental, en tenant ferment que leur foi ne les opprime pas mais les libère? Les féministes qui réclament l'interdiction du voile ne sombrent-elles pas dans une forme de "whitesplaining"? Cette questions rejoint d'ailleurs d'autres soulevées par le débat (au demeurant très compliqué et sur lequel j'ai beaucoup de mal personnellement à me positionner) sur la prostitution: peut-on "sauver" les prostituées, parfois malgré elles, sans donner une place centrale à leur témoignage, à leur situations personnelle et aux risques qui sont les leurs, et à l'exposé de leurs motivations?
Les recoupements évidents du racisme et du sexisme dans la vie réelle — leurs points d’intersection — trouvent rarement un prolongement dans les pratiques féministes et antiracistes. De ce fait, lorsque ces pratiques présentent l’identité « femme » ou « personne de couleur » sous forme de proposition alternative (ou bien…, ou bien…), elles relèguent l’identité des femmes de couleur en un lieu difficilement accessible au langage.
Les objectifs politiques des groupes militants peuvent en arriver à se contredire; le concept d’intersectionnalité permet donc de penser la convergence des luttes et la prise en compte des différences au sein des groupe minoritaires." (Genre! "Anti-homophobie et anti-racisme: la question de l'intersectionnalité").
Comme la philosophe féministe Elsa Dorlin le rappelle:
" A partir de 2004, en France, la problématique désormais résumée par le triptyque “sexe, race, classe" est devenue à ce point incontournable qu'elle a contribué à renouveler la portée critique du concept de genre comme concept d'analyse. La date de 2004 marque l'émergence d'un nombre significatifs de travaux de recherche mais aussi l'acmé de deux polémiques: celle relative à la prostitution, et plus particulièrementCe concept d'intersectionnalité a le gros avantage de répondre de manière efficace au reproche classique de "communautarisme" porté contre les mobilisations identitaires des minorités. Loin de mettre en danger le lien social et l'intérêt général par les revendications égoistes d'une minorité, aveugle à la complexité du monde, elles permettent de penser de manière dynamique l'interrelation de luttes diverses et souvent opposées en apparence, et de dépasser leurs antagonismes, pour les éclairant les unes par les autres, ouvrir la possibilité d'une convergence de l'ensemble des luttes contre l'exclusion et les inégalités.
à la mobilisation des personnes prostituées et des travailleuses du sexe contre la Loi sur la Sécurité Intérieure (2002) qui pénalise le racolage dit “passif”, et celle relative au port du voile —polémique qui connaît alors son quatrième épisode—. En définissant la prostitution et le voile musulman comme les pires des violences faites aux femmes, une partie du mouvement et de la pensée féministes contribue plus ou moins involontairement à objectiver les “victimes” de ces violences sous les traits d'objets mutiques sans défense et, par définition, non blanches —issues de l'immigration postcoloniale et/ou non “occidentales”—.
Ainsi, c'est dans ce contexte bien particulier que la question de l'intrication des rapports de pouvoir —de genre, de sexualité, de couleur, de “race”, de classe, mais aussi de religion, de nation, de génération ... — est devenue l'une des questions les plus controversées et les plus urgentes pour les études féministes et de genre." (Papeles del CEIC n°83, sept. 2012, "L'Atlantique féministe. L'intersectionnalité en débat").
Malgré son intérêt, et son très grand succès, il demeure cependant difficile à manier, dans la mesure où son efficacité comme descripteur de l'imbrication des rapports sociaux-culturel ne doit pas faire passer à l'arrière-plan sa dimension critique:
"A mon sens, les théories qui se réclament de l'intersectionnalité hésitent entre analytique et phénoménologie de la domination, utilisant la problématique de l'intersectionnalité pour penser une tension qu'elle n'a peut être pas théoriquement vocation à résoudre. En effet, d’un côté, c’est la domination qui est en soi intersectionnelle; d’un autre côté, ce sont certaines identités, certaines expériences vécues de la domination qui sont intersectionnelles. Comment comprendre cette hésitation? Premièrement, il me semble qu'elle est dû aux effets de traduction culturelle des outils d'analyse critiques que nous utilisons entre les deux rives de l'Atlantique notamment: en ce sens, il serait particulièrement intéressant de faire l'histoire des mutations du
concept d'intersectionnalité. Deuxièmement, je suis convaincue que le terme d'intersectionnalité, parce qu'il possède une certaine neutralité sémantique et une formalité critique, permet de régler à bon compte la question de l'engendrement des rapports de pouvoir en général et des points de vue dominants qu'ils édifient, en particulier. Je m'explique. L’idée d’une logique intersectionnelle de la domination suppose que toute domination est par définition une domination de classe, de “sexe” —de genre et de sexualité—, de “race”, de couleur... Autrement dit, les femmes “blanches”, hétérosexuelles, appartenant aux classes privilégiées sont littéralement interpellées comme telles dans un rapport qui est tout autant interpénétré d'hétérosexisme, de racisme et d’antagonisme de classe, que celui qui touche les femmes lesbiennes, racisées, pauvres et les confine dans des identités dites intersectionnelles. Or, toute la difficulté est que, jouissant de certains privilèges de genre, de sexualité ou de classe ou de nationalité et/ou de couleur... les femmes appartenant aux groupes dominants ne se perçoivent jamais sous ces rapports imbriqués; et, par conséquent, ne faisant pas à proprement parler l'expérience de leur “identité intersectionnelle”, elles ont tendance à construire leur politisation sur la base d'un seul de ces rapports de pouvoir —à l'exclusion de tous les autres—, en dépit même du fait que leur expérience de ce rapport, par exemple le sexisme, est intrinsèquement dépendant de leur classe, de leur sexualité, de leur couleur, de leur âge... Et ce sont toujours les “supers” dominéEs — celles et ceux qui sont à l'intersection d'au moins deux rapports de pouvoir!...— qui doivent vivre, agir et se penser selon une identité intersectionnelle, une condition segmentée, déchirée, un point de vue tiraillé sur soi et le monde, à l'intersection des rapports de pouvoir. [...]
Comme désaffiliée de son histoire, l’intersectionnalité “à l’européenne” n’est plus seulement un instrument critique du droit mais devient l’autre nom d’une description formaliste des rapports sociaux. L’intersectionnalité tend ainsi à remplacer ce que d’aucuns considèraient comme une litanie embarrassante, celle qui nomme un dispositif complexe, un appareil sophistiqué de rapports de pouvoir qui nous interpelle comme sujet8 au moment même où il rend méconnaissable nos expériences vécues, kaléidoscopiques, de la domination. Au cours de la traversée, l’intersectionnalité a sans doute perdu la tension intrinsèque entre analytique et phénoménologie de la domination qui la caractérisait, une tension qui exprimait précisémentConclusion: empowerment des minorités et promotion catholique du "bien commun":
ce qu’il nous revient toujours de penser." (Elsa Dorlin, op. cit.).
La thèse suivant laquelle la voix des dominés doit être prédominante dans la dénonciation et l'émancipation de l'hégémonie culturelle qui les invisibilise et les alène, a pour corrélat une certaine défiance envers les politiques topdown de lutte contre les discriminations, et a conduit à l'élaboration de notions telles que l'agency (la capacité à agir) ou l'empowerment, destinées à thématiser d'une prise de conscience et d'une libération par la base, sans passer par la médiation de dispositifs ou de discours liés à des catégories dominantes (au passge, prétendre par exemple que les femmes peuvent renverser les rapports de domination par leur "génie" propre, par exemple la séduction etc., et que donc le patriarcat en tant que concept serait simpliste, c'est oublier, ou feindre d'oublier, qu'on leur assigne alors comme instrument de leur "libération" les chaînes mêmes qui les lient à un "idéal" féminin abstrait, et redoubler leur aliénation: telle femme est-elle "suffisamment" séduisante, etc.? Ce sont à elles de décider de ce qui les libère, et non à quelque conception préétablie d'en haut et réductrice de déterminer ce qu'est leur "génie") :
"Les origines et sources d’inspirations de la notion d’empowerment sont multiples et peuvent être retracées dans des domaines aussi variés que le féminisme, le freudisme, la théologie, le mouvement black power ou le gandhisme (Simon, 1994 ; Cornwall, Brock, 2005). L’empowerment renvoie à des principes, telles que la capacité des individus et des collectivités à agir pour assurer leur bien-être ou leur droit de participer aux décisions les concernant, qui guident la recherche et l’intervention sociale auprès des populations marginalisées et pauvres depuis plusieurs décennies aux États-Unis (Simon, 1994). Il faudra pourtant attendre les années 1970, et notamment la parution en 1976 de l’ouvrage Black Empowerment : social work in oppressed community de Barbara Solomon, pour que le terme soit formellement utilisé par les chercheurs et les intervenants en service social. À la faveur des mouvements sociaux contestataires, le mot se popularise rapidement et s’utilise alors de façon croissante dans les travaux et interventions portant sur les communautés marginalisées comme les Noirs américains, les femmes, les gays et les lesbiennes ou les personnes handicapées.Si l'auteure du même article cherche à montrer que ce concept, trop vague, a été détourné de son objectif initial pour dépolitiser le pouvoir collectif, et a été récupéré et instrumentalisé par des conceptions top-down de la vie sociale et des politiques de développement, il reste utile pour penser une politique de libération des minorités par elles-mêmes, qui évite les écueils de l'"universalisme" républicain à la française, qui, en prétendant ne prendre aucun parti, favorise de facto le statu quo en faveur des discours hégémoniques.
5 Les premières théories de l’empowerment élaborées aux États-Unis sont donc ancrées dans une vision philosophique qui donne la priorité au point de vue des opprimés, afin que ces derniers puissent s’exprimer mais aussi acquérir le pouvoir de surmonter la domination dont ils font l’objet (Wise, 2005). Parmi les nombreuses sources d’inspiration des travaux sur l’empowerment, la méthode de la conscientisation développée par le Brésilien Paulo Freire dans son ouvrage Pédagogie des opprimées publié 1968 occupe une place de choix (Freire, 1974). La grande majorité des ouvrages sur l’empowerment y font d’ailleurs références. Partant de la « conscience dominée » des milieux ruraux brésiliens, expression de la « domination qu’un petit nombre de gens exerce dans chaque société sur la grande masse du peuple », Paulo Freire veut atteindre la « conscience libérée ». Il prône une méthode d’éducation active qui « aide l’homme à prendre conscience de sa problématique, de sa condition de personne, donc de sujet » et lui permet d’acquérir « les instruments qui lui permettront de faire des choix » et feront « qu’il se politisera lui-même » (Freire, 1974). « Le but de l’éducateur », souligne-t-il, « n’est pas seulement d’apprendre quelque chose à son interlocuteur, mais de rechercher avec lui, les moyens de transformer le monde dans lequel il vit » (p. 9)." (Revue Tiers-Monde 2009/4 (n°200), "Empowerment": généalogie d'un concept clé du discours contemporain sur le développement, Anne-Emmanuèle Calvès).
Et de fait, et sans idéaliser outre-mesure les politiques des identités à l'anglo-saxonne, c'est belle et bien la prise de conscience politique des minorités (qu'il s'agisse des femmes, des noirs, des homosexuels, etc.) et leur activisme qui a mené à une amélioration significative, aux 20ème et 21ème siècle, de leur condition. Les beaux principes humanistes abstraits de la République n'y ont pas suffit, même s'ils ont pu les faciliter dans une certaine mesure. Ni d'ailleurs la conception du "bien commun" défendue par l'Eglise, dont on peut se demander si, à force de privilégier la complémentarité et la collaboration entre les classes et les sexes et le statu quo, elle ne finit pas par de fait, au non de la non violence, par renforcer l'hégémonie et les privilèges de quelques uns, et instituer un monopole de la violence structurelle et du pouvoir social. De fait, il est difficile de retracer ce qui revient à l'Eglise dans l'émancipation (il y a eu des choses très importantes, et la théologie du corps de Jean-Paul 2 est à certains égards par exemple une tentative de prise en compte certaines revendications féministes, mais l'Eglise n'a pas été pilote dans ces combats comme elle aurait pu, à mon sens, l'être), qu'aujourd'hui peu de catholiques remettent en cause, de ces minorités, alors qu'on peut trouver assez facilement des moments où elle semble avoir tenté de les freiner, voire de les stopper.
Tant que l'Eglise n'aura pas pris toute la mesure et l'urgence de ces questions d'hégémonie culturelle et d'émancipation des exclus et des dominés par eux-mêmes, leur témoignage et leur réappropriation de ce qu'ils sont et veulent devenir, et non par quelque discours bienveillant (voire paternaliste) généraliste et venu d'en haut, elle n'aura pas à mon sens dépassé les objections, contre sa doctrine sociale, de la gauche athée, ni celles en provenance de sa propre composante d'ouverture.