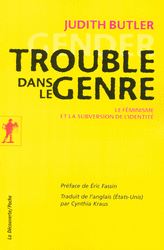Ce billet se propose de répondre à un article du blogueur catholique Fikmonskov, "De Darwin à John Money, de l’évolution au genre : un même objectif, les mêmes méthodes…".
Fik, donc, réagit lui-même à un billet de Denis Colombi, professeur agrégé de sociologie dans le secondaire et blogueur, où celui-ci exprime sa frustration, en tant qu'enseignant, face au recul de Vincent Peillon sur l'enseignement de la soit-disant "théorie du genre", sous la pression de politiques de droite et de lobbyistes pour l'essentiel catholiques.
Il lui adresse les reproches suivants:
- L'exemple de l'expérience de la boite de Schwalbe, sur lequel Denis Colombi s'appuie, serait une "arnaque":
"L’arnaque est toute entière dans cet exemple : en effet, il faut être très con pour penser qu’un gamin élevé dans une boite imperméable au monde extérieur soit le même que s’il est élevé correctement. Ne serait-ce que parce qu’après 18 ans dans une boite, il est probable qu’il soit devenu complètement dingue… Mais même sans ça, nul ne viendrait contester que deux jumeaux élevés dans des familles différentes ne resteront pas aussi semblables que s’ils étaient élevés dans la même famille. Imaginons rapidement – parce que franchement, bon – un jumeau élevé dans une famille français classique, et l’autre élevé dans une famille aborigène typique. Bon, eh bien en effet le deuxième ne boira pas son thé de la même façon que le premier."
-Le parallèle esquissé par Denis Colombi entre la réception des études de genre et celle de la théorie de l'évolution, mettrait en évidence la propension de ces deux champs du savoir à s'appuyer sur des "évidences" mises en avant de façon fallacieuses dans le but de faire passer leurs contradicteurs, de manière automatique et (trop) commode, pour des imbéciles:
"Mais non, la théorie de l’évolution était prouvée. Dont acte. Et quiconque la contredit se voit taxer de "créationniste" et se prend l’expérience des papillons (ou une autre du même genre ; les ours blancs marchent assez bien aussi) dans la figure, comme une preuve incontestable que l’homme descend du cœlacanthe.
—
C’est exactement ce que fait Denis Colombi : un présentant un exemple qui ne prouve rien d’autre qu’une évidence absolue que personne ne songerait un instant à nier, il prétend renvoyer les opposants à la niche."
Fik revient sur ce parallèle en conclusion de son article, pour nous apprendre qu'aussi bien la théorie de l'évolution que les études de genre auraient pour finalité d'"emmerder l'Eglise" et de "reléguer la Bible, ce vieux bouquin qui dit que "homme et femme il les créa", au rang de cale-meuble".
- Enfin, le billet de Denis Colombi occulterait le véritable visage de la "théorie du genre", que Fik s'emploie au contraire à mettre en évidence en nous rappelant qu'il s'agit de l'enseigner, non pas à partir de la première, mais dès les plus jeunes classes, et en nous informant des résultats d'une expérience dramatique menée par John Money, un psychiatre précurseur de ce nouveau champ du savoir, qui révèlerait leur caractère nocif.
Après avoir lu et relu, le plus calmement et sereinement qu'il m'a été possible, ce billet de Fik (et d'autant plus que le blog qui le publie est d'ordinaire de qualité, bien qu'il exprime des opinions généralement très éloignées des miennes), ma réaction spontanée fut la suivante:
Trois remarques de fond qui me permettront, j'espère, de donner la mesure de mon désarroi:
1) Démonstration par l'absurde et absurdité de la contre-démonstration
La plus grosse erreur de Fik est à mon sens de confondre la pédagogie, la transmission des savoirs, qui est le travail de l'enseignant, avec leur démonstration et leur mise à l'épreuve, qui constituent celui du chercheur.
Ainsi, les schémas auxquels nous avons effectivement été tous confrontés dans notre enfance, qui nous présentent, de manière rectiligne, l'évolution des espèces, ne sont pas destinés à démontrer quoique ce soit, mais à vulgariser, de manière imagée et simple à appréhender, le consensus du moment en matière d'états des savoirs scientifiques. Cela a certes un nombre non négligeable de conséquences, en terme de simplification des réalités abordées (ainsi ces schémas justement qui présentent de manière finaliste un processus que la théorie de l'évolution décrit au contraire comme aveugle et plein d'aspérités et de culs de sac), de survol des difficultés théoriques et de passage sous silence du caractère provisoire des connaisances scientifiques (si l'on admet avec Popper que le critère du discours scientifique est sa capacité à être réfuté, alors il faut bien admettre que, même dans le domaine des "sciences exactes" , les "évidences" et les "certitudes" absolues deviennent au fil du temps des denrées fort rares). Qui font d'ailleurs soupirer, d'après mes souvenirs d'étudiant, bon nombre d'enseignants des niveaux supérieurs (désapprendre pour mieux apprendre, toussa...).
Alors certes, les militants de théories tombées en désuétude, ou non acceptées par la majorité de la communauté universitaire, les défenseurs de l'"intelligent design" par exemple, qui est la version intello du créationnisme, ont beau jeu de souligner que ces simplifications, surtout à un très jeune âge, donnent un caractère d'évidence et d'irréfutabilité à des thèses qui sont au contraire discutables et remplies de zones d'ombre, et de dénoncer une science "officielle", "idéologique", "aux ordres" d'intérêts contingents.
Sauf que j'ai bien du mal à voir quelle autre alternative serait plus viable: renoncer à enseigner aux enfants les savoirs incertains (c'est-à-dire, en fait, l'absolue totalité des savoirs académiques à part peut-être les mathématiques)? Ou au contraire leur donner les démonstrations complètes, pour qu'ils puissent juger? Ce qui, dans le cas de la théorie de l'évolution (parce que non, les biologistes ne sont pas complètement débiles, même Richard Dawkins malgré ce que son compte twitter pourrait suggérer, et ne se contentent pas de mettre bout à bout sur une ligne des espèces similaires, mais de forme de plus en plus complexe, pour "prouver" leurs thèses), reviendrait à faire commencer les études universitaires en primaire. Ou enfin, antienne favorite des créationnistes, "donner le choix" et présenter en regard les deux théories: darwinisme et intelligent design? C'est précisément oublier que l'école élémentaire et le second degré n'ont pas pour but de démontrer les savoirs, ni de trancher les nombreuses polémiques et obscurités qui sont le lot quotidien des chercheurs, mais de donner une éducation minimale commune, à partir de ce qui fait globalement consensus chez les experts (et il est évident que ce qui fait consensus évolue: on enseignait hier des choses qu'on affirme comme fausses aujourd'hui, et cette évolution impacte aussi les programmes de seconds et premiers degrés, ne serait-ce que parce que les enseignants (et les inspecteurs) sont formés à l'Université, et que pour le coup, l'indépendance de l'enseignement et de la recherche au niveau du supérieur est constitutionnellement protégée). Enseigner deux thèses contradictoires à des enfants, c'est peut-être le meilleur moyen qu'ils ne retiennent rien du tout, ou qu'ils tombent dans un relativisme qui les rendra méfiants à l'égard de la science en général: pas sûr que ce soit un meilleur cadeau pour eux que la théorie de l'évolution, y compris fortement simplifiée.
Le texte suivant souligne bien les enjeux et difficultés de l'enseignement à l'école de l'évolution des espèces, en rappelant bien que c'est la réfutabilité qui fonde le discours scientifique (et à partir du moment où on explique l'évolution des espèces par l'action d'une volonté intelligente et invisible, on a recours à une interprétation qui ne peut être ni discutée ni réfutée: on sort donc du domaine stricte de la science):
"[...] Dans la langue française, le mot théorie a deux sens :
1. « Ensemble d'idées, de concepts abstraits, plus ou moins organisés, appliqué à un domaine particulier »
2. « Construction intellectuelle méthodique et organisée, de caractère hypothétique (au moins en certaines de ses parties) et synthétique. Éléments de connaissance organisés en système ».
Le premier sens appartient au langage courant et correspond souvent à des faits imparfaitement ou peu étayés, alors que le second appartient au langage des sciences ; de ce décalage naissent beaucoup d’incompréhensions. La théorie de l’évolution est une théorie scientifique. Comme pour toute théorie scientifique, certains points font l’objet de discussions entre les chercheurs, mais cela n’implique pas que la théorie elle-même soit à rejeter.
La théorie de l’évolution est une théorie scientifique …en évolution
La théorie de l’évolution est la seule explication scientifique permettant de comprendre la diversité actuelle et passée des êtres vivants, mais aussi l’unité du monde vivant.
Pourquoi ?
L’analyse des faits, sans en occulter aucun, conduit à l’idée que les êtres vivants ont connu des transformations successives au fil du temps et sont tous apparentés à différents degrés. Elle permet d’expliquer les ressemblances et les différences entre les êtres vivants. Elle appartient au domaine scientifique et ne fait appel à aucun créateur ou force surnaturelle, une condition nécessaire pour qu'une théorie soit scientifique.
La théorie de l’évolution n’est pas un discours figé. Les travaux se poursuivent et affinent, précisent les résultats antérieurs et en proposent de nouveaux. Près de 150 ans de travaux scientifiques n’ont pas invalidé l’idée d’évolution, mais ils en ont détaillé, confirmé et enrichi de nombreux aspects. S’agissant d’une théorie scientifique, il est possible qu’elle soit un jour invalidée, comme le furent d’autres théories scientifiques, mais ce ne peut être que par des découvertes susceptibles de la réfuter, c'est-à-dire par de nouvelles preuves scientifiques, qui devront être en mesure de balayer ou reconsidérer 150 années de découvertes convergeant toutes dans le même sens.
[...]
La plupart des oppositions à la théorie de l’évolution ne s’inscrivent pas dans un cadre scientifique car elles ne respectent pas les principes sur lesquels la science se fonde. En faisant appel à des causes surnaturelles ou à des croyances personnelles pour rendre compte de la diversité du monde vivant, elles s’excluent de fait, dès le départ, du discours scientifique. Seules des affirmations qui peuvent être soumises à la réfutation par des observations ou des expériences peuvent être considérées comme scientifiques. C’est pourquoi les discours qui s’opposent à la théorie de l’évolution, comme les thèses créationnistes ou celle du « dessein intelligent », ne sont pas des théories scientifiques."
Pour revenir à l'exemple donné par Denis Colombi dans son billet, il est tout aussi clair que son but n'était pas de "prouver" les études de genre, mais d'expliquer ce qu'elles disent vraiment, et qui apparait fort peu compris en France, en particulier dans les milieux catholiques: elles ne nient pas le donné biologique, ni ne se bornent à constater l'évidence que certaines des différences associées aux sexes sont d'ordre culturel, et font encore moins la promotion d'une interchangeabilité à volonté des sexes (même sur leur versant politisé, des auteurs affirment le contraire de cet énoncé: cf. Judith Butler). Elles étudient simplement toutes les différences que notre société (ou d'autres) pose (nt) entre les sexes et qui ne sont pas explicables par le seul donné biologique: ce qui permet de montrer, dans de nombreux cas, que des "évidences" naturalisés sont en réalité des constructions sociales, nées de l'habitude, voire de relations de type hiérarchique invisbilisées par les usages (j'y reviens dans ma troisième remarque). En ce sens, et comme il le souligne lui-même en commentaire, l'exemple de la boite de Schwalb n'avait pas la portée d'une "preuve", mais se voulait pédagogique. Il s'agissait d'une démonstration par l'absurde, destinée à montrer à des néophytes toute la difficulté à penser l'homme "naturel", dont on clame sans cesse l'"évidence", sans toutefois arriver à la décrire, dans la plupart des cas, qu'en glissant sur le terrain du culturel et du social. Je prenais moi-même pour exemple, dans un billet précédent, le cas de la grossesse: que celle-ci soit un fait biologique, c'est évident: mais quand glisse vers le "rôle" du père et /ou de la mère, on rentre dans le culturel: celui-ci est vécu de manière très différente suivant les cultures et les sociétés (quel rapport entre le pater familias de la Rome antique, qui avait droit de vie et de mort sur sa progéniture, et ces droits des enfants qu'on revendique à juste titre aujourd'hui?). Et comme il s'agit d'une démonstration par l'absurde, évidemment que l'exemple employé est... absurde. Prétendre le démonter en soulignant ce fait, c'est tout simplement enfoncer des portes ouvertes et donner la preuve qu'on n'a rien compris au propos de l'auteur. Car celui-ci ne dit pas: "considérez cette expérience, et vous aurez la preuve que tout est culturel et que rien n'est biologique", mais: "en réfléchissant à cet exemple nous réalisons qu'il est difficile de penser le biologique détaché de toute référence culturelle. Voilà qui doit nous inciter à la prudence face aux "évidences naturelle", et à privilégier de manière méthodologique les explications culturelles, en n'ayant recours à l'interprétation par le déterminisme naturel que quand il ne reste plus d'autres hypothèses".
Quand à se plaindre que la théorie de l'évolution et les études de genre font rien que tout casser dans la Bible, cela me parait marquer une régression remarquable d'une partie des catholiques, depuis la relative ouverture initiée par Jean-Paul II:
"Après Vatican II, l'Église catholique reste discrète sur cette doctrine jusqu'au 23 octobre 1996 lors d'une intervention devant l'Académie pontificale des sciences du pape Jean-Paul II
Il y déclare que « près d’un demi-siècle après la parution de l’Encyclique (Humani generis), de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l’évolution plus qu’une hypothèse », nuançant en précisant qu'il faut parler davantage pour ces variations de théories de l'évolution.
Par ailleurs, il affirme que certaines d'entre elles « qui, en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l’esprit comme émergeant des forces de la matière vivante ou comme un simple épiphénomène de cette matière, sont incompatibles avec la vérité de l’homme »."
Comme Anthony Favier, historien et doctorant en études de genre, le soulignait la semaine dernière sur son blog:
"Il y a quelques temps, un professeur de sociologie à l'Université m'indiquait dans un message "ce que font les évangéliques américains avec l'intelligent design les catholiques français le feraient avec le refus du "genre" et leur conception de la famille". J'ai trouvé cela excessif sur le moment, mais, désormais, je me dois de reconnaître qu'il mettait peut-être le doigt sur un des aspects les plus étonnants d'une forme d'anti-modernité catholique.
Alors que le créationnisme semblait circonscrit à la sphère fondamentaliste, plutôt protestante, ou au catholicisme traditionaliste, peut-être que, appelons le ainsi, le "strict différentialisme hétérosexuel" sera le front le plus vif de la rencontre entre les sciences religieuses chrétiennes et les évolutions des sciences tant biologiques qu'humaines et sociales."
Ce qui ne signifie pas qu'en tant que chrétien, nous n'avons pas à continuer d'annoncer une Espérance dont l'écho n'est guère perceptible dans la théorie de l'évolution. Mais notre cheminement de foi vers cette surnature qui viendra accomplir la Création, et notre témoignage de cette attente, ne doivent pas nous conduire à mépriser les savoirs et les modèles d'explication actuels de la nature, ni à les caricaturer.
2) John Money et le temps cyclique
Toutes les modes finissent par passer, et même celle de taper sur Judith Butler. Le nouvel épouvantail de la "théorie du genre" est John Money.
Le "mérite" en revient à la page Facebook "Toute la vérité sur l'inventeur des gender studies", qui présente sa démarche dans les termes suivants:
"À propos
MERCI DE CLIQUER SUR "À PROPOS" CI-DESSOUS, AFIN D'ACCÉDER À LA PAGE WIKIPÉDIA SUR LE DOCTEUR JOHN MONEY.
Description
WARNING. Le cas de John Money n'a strictement rien à voir avec l'homosexualité. Nous avons créé cette page dans le but d'alerter la presse, les institutions françaises, le grand public - et particulièrement les parents d'élèves - sur les origines de la Théorie du Genre : la folie de son créateur, sa pédophilie assumée, ses mensonges, les conséquences meurtrières de ses expérimentations et son influence toxique sur la pensée contemporaine. Nous récusons par avance, et avec fermeté, tout soupçon d'homophobie."
Tout cela fait sourire quand on sait, d'une part, que la contributrice qui a initié l'écriture de cette page wikipédia consacrée à John Money est une partisane convaincue des études de genre, et d'autre part, que John Money n'est pas, leur "fondateur".
Je pourrais me contenter de renvoyer vers le blog d'Anne-Charlotte Husson, agrégée de lettres modernes et chercheuse en études de genre, qui vient de publier une mise au point sur cette question:
"Où l’on réalise que le combat contre la "théorie du genre" doit beaucoup à… la théorie du complot. Le psychologue John Money a en effet utilisé le concept de "genre" (gender) pour désigner ce qui, dans l’identité "féminine" et "masculine", ne relève pas du biologique. Ce n’est cependant pas l’inventeur du concept, qu’on doit à une conjonction de travaux, et en particulier à ceux menés dans les années 60 par le psychiatre Robert Stoller sur l’identité sexuelle. On peut aussi remonter aux travaux de l’anthropologue Margaret Mead, mettant en évidence le caractère social de ce qu’on désignait jusqu’alors comme des caractéristiques naturelles sexuées. Il est bien plus utile cependant pour les adversaires des études de genre de se concentrer sur la figure de John Money, qui prônait effectivement la tolérance envers la pédophilie et pensait que les personnes intersexuées devaient être réassignées vers un sexe ou l’autre; son traitement du cas de David Reimer est devenu célèbre. De plus, ce que l’on appellegender studies (études de genre, études sur le genre) n’a pas été créé par Money ou Stoller mais est issu de la réappropriation par les féministes de la "2ème vague" du concept de genre. Cette réappropriation conduit rapidement à s’éloigner de l’usage original du concept."
Mais comme il s'agit d'un blog militant, dont on ne trouve généralement les billets géniaux que lorsqu'ils confirment notre propre camp, je sens que pour être lu, je vais aussi devoir faire appel à Philarête, l'auteur du blog L'esprit de l'escalier, catholique et méfiant envers les études de genre (lui-même parle de déception). Ce dernier propose, sur deux billets, un petit parcours des origines des études de genre, qui ne consacre que quelques lignes, tout à la fin du second billet, à John Money, très proches dans leur contenu du rappel d'Anne-Charlotte Husson::
"En 1955, John Money publie un article sur l’hermaphrodisme, qu’il signe avec ses collègues de Baltimore, John et Joan Hampson : c’est la première théorisation du « genre », qu’il associe ici à la notion de « rôle de genre ». Money entend séparer nettement les aspects biologiques et les aspects « sociaux » du sexe ; il soutient, à propos des hermaphrodites, que le « sexe d’élevage » prime le sexe biologique, y compris lorsque l’assignation du sexe est erronée selon les critères biologiques. Money se réclame de la sexologie et est un spécialiste de l’endocrinologie. Ses travaux inaugurent une décennie particulièrement féconde. Bientôt, depuis l’université de Los Angeles (UCLA), le docteur Robert Stoller « répond » à Money, à partir de ses propres travaux portant, non sur l’hermaphrodisme, mais sur le transsexualisme. En 1964, c’est Stoller qui introduit dans un article la notion d’« identité de genre » (gender identity). Stoller est psychiatre et psychanalyste : paradoxe de cette histoire, malgré ses réticences croissantes à l’égard des travaux de Money et sa pratique des « réassignations de sexe », Stoller sera finalement celui qui consacrera la distinction entre sexe et genre, dans le livre déjà cité, Sex and Gender, qui paraît en 1968."
Comme quoi il parait très arbitraire de faire de John Money le "créateur" de la "théorie du genre".
Au passage, lorsque Fik écrit:
"Et il [Denis Colombi] oublie donc, évidemment, que l’expérience a viré au drame : les deux jumeaux, dont l’un des deux, né garçon, a été éduqué en fille après une opération ratée qui lui a détruit le pénis, se sont suicidés."...
... Faisant ainsi d'une opération chirurgicale désastreuse, mais ponctuelle, l'aboutissement d'une réflexion générale sur les aspects biologiques et sociaux du sexe, ne reconduit-il pas l'erreur de raisonnement qu'il reproche (à tord) à Denis Colombi, en érigeant un évènement isolé (et qui lui permet par ses aspects spectaculaires de gagner à bon compte l'indignation des lecteurs), mais qui l'arrange, en règle?
De manière générale, ce qui est amusant dans cette fixation de certains catholiques sur John Money, c'est ce que ça révèle de leur conception du temps. J'avais cru comprendre que le temps chrétien se pensait de manière linéaire, comme une attente, dirigée en avant, de l'accomplissement de La Promesse de la Seconde Venue. Quand je lis ce genre de théorie du complot, j'ai plutôt l'impression d'un temps cyclique, qui, à la manière de la cosmogonie hindoue, retourne de manière inéluctable à une catastrophe primoridale et originaire: la "thorie du genre" aurait été "créée" par un pervers, et donc, inévitablement, ne peut aboutir qu'à des perversions encore plus grandes. On s'imagine presque une transmission secrète: comme une cérémonie, que vivrait chaque chercheur en études de genre la veille de sa soutenance de thèse, où, paré des habits de l'autre sexe, il jurerait, la main sur un exemplaire des Manuscrits Révélés de John Money, d'anéantir la différence des sexes et les racines chrétiennes de notre civilisation. C'est faire peu de cas du phénomène souvent observé de la prise d'autonomie des champs du savoir par rapport aux doctrines qui ont présidé à leurs origines: ainsi la sociologie s'est-elle dissociée du positivisme, l'ethnologie et la linguistique du structuralisme, et les études de genre ne se résument plus aux études féministes.
3) Eglise et culture de viol
Mais allons plus loin. Fik ne l'évoque pas dans son billet, mais l'un des aspects les plus choquants de la vie de John Money fut sa complaisance pour la pédophilie. Ce rapprochement, au demeurant absurde, entre les crimes de John Money et la finalité et les méthodes des études de genre dans leur ensemble, permet au moins de poser une bonne question: l'approche que ces dernières proposent de la sexualité a-t-elle pour conséquence de favoriser une conception plus responsable de celle-ci, ou au contraire plus permissive, voire violente?
L'objet des études de genre, comme Denis Colombi le rappelle fort justement, est d'étudier les sexes, les attributs et les comportements que nous leurs associons communément, et leurs relations entre eux, et notamment, de traquer et de mettre en évidence les conditionnements culturels qui nous amènent à naturaliser, et à considérer comme des conséquences directes du donné biologique, des déterminismes, dans notre manière de concevoir les sexes, cosidérés isolément ou dans leurs interactions, qui sont en fait d'origine sociale.
Cette démarche conduit-elle à favoriser une approche plus permissive de la sexualité, moins respectueuse de mon corps et de celui d'autrui que celle qui pose les différences entre sexes comme des réalités naturlles indépassables, ou permet-elle au contraire une approche plus responsable de ces questions?
Je ne traiterai pas, dans les lignes qui vont suivre, cette question de manière détaillée. J'y reviendrai de manière plus approfondie dans des publications ultérieures. je me permettrai juste une très courte remarque:
La"nature", les "pulsions", les "instincts", la "virilité", l'"appétit", il s'agit là de termes qui sont récurrents, dans la bouche des... violeurs, harceleurs, voyeurs, maris violents, pédophiles, et autres machos et minimisateurs fréquents des conséquences violentes de l'assouvissement effréné des désirs. La "naturalisation" des différences entre sexes, ce n'est pas seulement ce "fondement" de l'anthropologie chrétienne tant célébré et défendu. C'est également cette dépersonnalisation du désir qui permet aux agresseurs sexuels de justifier des postures de dénis, voire de victimisation et de rejet des responsabilités su l'agressée. Et qui donne de la substance à des disocurs que nous entendons très fréquemmment, et pas nécessairement de criminels, qui disent qu'une femme qui sort tard le soir ou qui s'habille d'une certaine manière "prend des risques", ou qu'un homme a besoin de relations sexuelles fréquentes pour garder son équilibre (l'abstinence mènerait à la pédophilie par exemple). J'ai lu cette semaine l'exemple d'une féministe que je suis sur twitter, qui expliquait à son docteur qu'elle voyait son copain moins d'une fois par semaine, ce lui valait en réponse l'avertissement suivant: à cet âge, un garçon aurait beaucoup de besoins, et le voir moins de deux fois par semaine, ce serait s'exposer au risque d'une rupture.
Notre vie quotidienne est remplie de ces petis exemples, qui font de la force du désir, de son caractère pulsionnel, instinctif, un attribut masculin, et de son assouvissement une responsabilité féminine. Une naturalisation des différences sexuelles qui ert trop souvent de justification bien pratique à ceux qui font le choix de vivre leurs désirs sans contraintes ni régulations, quitte à blesser autrui. Et qui fait que les victimes sont souvent culpabilisées par elles-mêmes ou une partie de leur entourahe, et qu'il se trouve toujours des voix pour excuser les "pulsions". Ce que les féministes désignent sous le terme de "culture du viol":
"Des hommes, en toute tranquillité, visage découvert, violent des femmes et se filment. Les jeunes violeurs de Steubenville ont déclaré qu’ils n’avaient pas conscience que ce qu’ils faisaient étaient mal. Lors des procès pour viol chez les mineurs, beaucoup déclarent la même chose. Et je pense que c’est vrai. Je pense que beaucoup de gens – hommes comme femmes – ne savent pas vraiment qu’un viol c’est mal. Que beaucoup de gens ne voient au fond pas grand mal à violer. J’exagère ? 50 000 viols par an en France. Parce qu’il y a toujours de bonnes raisons à dire que cela n’était pas vraiment un viol.
Sauf que la société dans laquelle nous évoluons, nous en sommes tous responsables, hommes comme femmes. Quand nous avons dit « celle là faudra pas s’étonner », quand nous nous sommes branlés sur un porno où la fille après avoir braillé non a fini par dire oui, quand nous avons dit non en espérant qu’il continue quand même, quand nous avons harcelé jusqu’à ce qu’elles disent oui, quand nous avons dit à une féministe qu’elle méritait un bon coup de bite, quand nous avons dit à une copine qu’elle n’avait pas qu’à autant boire et puis que ce mec il est sympa, quand nous avons condamné à une peine légère un violeur car il a depuis refait sa vie, quand nous avons filmé des images de viol, quand nous avons parlé de troussage de domestique, quand nous avons commenté le physique d’une supposée victime, quand nous avons dit que c’était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, quand nous avons souhaité le viol d’une adversaire politique, quand une journaliste de CNN pleure sur la vie détruite de deux adolescents, quand une journaliste française pleure sur le sort d’un accusé célèbre, quand on explique qu’une gamine de 13 ans faisait plus vieux, quand des flics violent des prostituées en toute impunité, quand Lara Logan est accusée d’avoir traîné dans des lieux où elle n’avait pas à être, quand une femme dit qu’un chanteur connu venait coucher avec elle alors qu’elle avait 14 ans, quand une tentative de viol dans un jeu video est jugée excitante, quand nous avons tu notre viol parce que le dire était le meilleur moyen de voir notre vie foutue en l’air.
La culture du viol naturalise le viol ; elle explique qu’il existera toujours et qu’il faut faire avec. Elle valide les mythes autour du viol comme de dire que le viol est commis en majorité par des étrangers alors que la plupart des viols sont commis par des hommes connus par la victime. Elle sexualise le viol en disant que le viol a quelque chose à voir avec la sexualité ; et qui irait se plaindre de la sexualité, c’est bon la sexualité non ?" (Valérie Crêpe-Georgete, Comprendre la culture du viol).
Considérées sous cet angle, les études de genre donnent des outils très utiles, indispensables même, pour débusquer ces fausses excuses, ces tentatives de légitimation par "la nature" d'un usage irresponsable des désirs et de la sexualité. En mettant en évidence le caractère construit, culturel, contingent, des "désirs", elles permettent d'affaiblir très fortement l'argument de la "pulsion". A ce titre, comme le respect d'autrui et la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal s'apprennent dès les plus jeunes classes, réfléchir à des applications, très tôt, des études de genre à l'éducation des plus jeunes me parait, non pas une aberration, mais une question pertinente et urgente.
Enfin, si l'Eglise, les reprenait à son compte, elle se donnerait, dans la lutte qu'elle entend mener contre "relativisme culturel et moral", un levier bien plus puissant que toutes ces théories du complot grotesque, qui, tout en dénonçant des périls imaginaires, contribuent à leur insu à légitimer des comportements pour le coup réellement immoraux, en érigeant de manière unilatérale et aveugle la "nature" comme la voie royale pour comprendre la réalité de chaque sexe et de ses relations avec l'autre. Car l'intérêt des études de genre, c'est justement de montrer que les désirs sexuels les plus sombres ne sont pas une fatalité, que la nature n'explique pas à elle seule les aberrations du désir humain, et que progresser ensemble vers une société où sexualité et respect rimeront est possible.